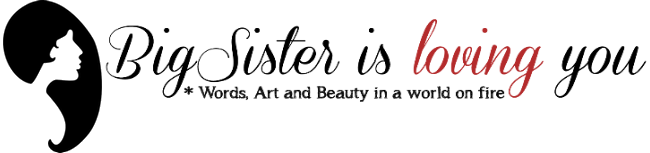Un matin aux urgences. Une salle dans une lumière blafarde, des personnes recroquevillées sur leur douleur, silencieuses. Nous attendons.
Ma fille s’amuse sur son fauteuil roulant, attendant qu’on examine sa cheville enflée. Une autre fillette la regarde, lui sourit et s’approche. Elle s’empare bientôt des poignées de l’engin et vroum, démarre une course folle et gaie entre les travées de la salle d’attente. La fillette semble avoir oublié son petit doigt violacé et tuméfié, et ma fille, sa cheville fracassée.
J’échange des sourires avec la maman, une femme brune aux cheveux courts, toute de noire vêtue. Son visage est rond, son sourire d’une grande douceur. Ses yeux luisent comme deux pépites obscures. Nous engageons la conversation, on parle de nos petites blessées. Et puis je découvre rapidement qu’il y a parmi nous une vraie grande blessée, et c’est elle. Je ne me souviens pas comment, ni pourquoi, mais très tôt, elle me dit qu’elle est une patiente oncologique. C’est un mot qu’on emploie rarement, c’est un mot qui fait peur, qui terrorise. Je me demande si j’ai bien entendu, mais elle enchaîne et les doutes s’évanouissent.
Nous sommes assises l’une face à l’autre. Il y a des dizaines de personnes autour de nous. Anna, puisque c’est son prénom, parle fort, indifférente à ceux qui l’entourent. Anna veut me raconter. Elle est un livre ouvert. Il y a des dates d’abord. Celle du jour, 29 janvier 2018, date d’anniversaire de ses triplés, où son fils pose sa main – « la main de Dieu », dit-elle- sur sa poitrine, brutalement, provoquant l’apparition dès le lendemain d’une noix de quatre centimètres sur un sein. Quinze jours d’attente après la biopsie, puis la nouvelle, éclatante, impossible, inconcevable d’une tumeur maligne et agressive. Anna a 38 ans, trois enfants de onze ans, pas de temps à perdre, une guerre à gagner, la défaite étant impensable. Anna me montre des photos sur son téléphone : elle, le 29 janvier, le jour de la fête, dernier jour d’insouciance, les cheveux longs, véritable beauté méditerranéenne, plus mince qu’aujourd’hui ; puis des photos d’elle avec le crâne qui se dégarnit, puis la séance chez le coiffeur avec sa mère, qui en profite pour se couper les cheveux court, comme sa fille. Sur tous ces clichés, Anna a le même sourire, si doux. Elle me montre les photos avec la cicatrice sur sa poitrine grâce à laquelle la chimio pouvait répandre dans son corps le liquide salvateur. Elle m’explique tout, car je n’y connais rien. Elle me parle de l’opération qu’elle a subie, des veines du bras qui risquaient de brûler, car la chimio est corrosive, elle m’en parle avec le sourire, Anna, parce qu’elle a gagné, parce qu’aujourd’hui elle est une rescapée, une survivante. Il y a son mari aussi sur les photos, qui a toujours été là, avec elle. Elle n’a jamais été seule dans cette bataille. Elle répète : « on ne vit qu’une fois » ; elle veut que son mari arrête de travailler dans la restauration car ses horaires impossibles ne leur permettent pas d’avoir une vie familiale normale, «On ne vit qu’une fois » répète t-elle, avec force et conviction.
Je me souviens avoir traversé, il y a quelques années, une salle dans une clinique de Paris, où des personnes venaient se faire administrer la chimio qui allaient peut-être les sauver, peut-être pas. J’avais ressenti dans mon ventre l’angoisse qui imprégnait les lieux, j’avais senti les appels à l’aide, la détresse des fantômes de ceux qui venaient là. Ils étaient si forts, ces hurlements silencieux, que j’en étais ressortie bouleversée.
Chez Anna, pas de tristesse, juste ce besoin, cette urgence à dire, pour expurger ce qui reste de cette sale bête qui a décidé de se nicher dans son corps. La bataille n’est pas finie, elle le sait, mais elle a décidé qu’elle ne mourait pas.
Avant de nous quitter, nous échangeons nos numéros de téléphone, nos filles ont bien accroché, j’aime bien Anna, j’ai envie de prendre de ses nouvelles, de la revoir. Elles rentrent en bus. Comme elles habitent un quartier périphérique, je lui demande pourquoi elles ne se déplacent pas à vélo, comme tout le monde. Anna me dit qu’elle a peur des accidents, qu’elle ne se la sent pas. Je suis étonnée mais je ne dis rien. Les héroïnes peuvent avoir aussi leur talon d’Achille.