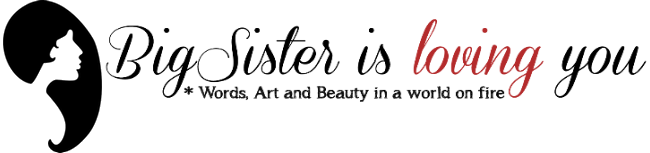J’avais fait son portrait il y a quelques années pour un journal en ligne. Je vous le propose, parce que j’ai envie de vous parler d’elle. Au revoir, mon amie. Tu resteras toujours dans mon cœur.
Maki, 41 ans, japonaise
Graphiste
Le dos de Maki arbore une longue natte brune et luisante. Elle parle français avec un accent délicat, déguste son thé brûlant à petites gorgées timides. A ses côtés, inquiétante et rigide, une canne métallique, seule trace visible de la maladie qui la ronge. Maki est atteinte d’ataxie cérebelleuse type 6, une pathologie neuromusculaire, évolutive, rare (elle concerne moins de vingt mille personnes en France) et génétique. Chez Maki, cette maladie est une histoire de famille puisque elle est la cinquième génération de femmes atteinte.
Sur ses premières années sur l’île d’Honshu, à Kesennuma, tranquille ville côtière, située à 650 kilomètres de Tokyo, Maki est peu loquace. Comme si cette période sans bruit ni cassure n’était qu’une préhistoire dérisoire, un préalable morne à la grande aventure de sa vie qui allait s’écrire entre Tokyo et Paris.
On retiendra que dans cette ville du Pacifique, tous les hommes sont pêcheurs. Sauf le sien. Quand les autres enfants grandissent dans l’ombre d’un père absent, Maki subit la présence d’un père commerçant sévère, peut être trop présent. Sans doute cela explique t’il que Maki songe très tôt à quitter le nid familial. Et puis sans doute aime t’elle trop vivre pour se résigner à une vie de province.
A l’adolescence, Maki s’imagine travailler dans la mode, sans idée précise du métier qu’elle voudrait y exercer. Après le lycée, en 1986, elle quitte province et famille pour Tokyo, là où tous les rêves sont possibles. Elle intègre le Tokyo’s Bunka Fashion College, la grande école de mode qui a formé Yamamoto, Kenzo, les plus grands noms de la mode nippone… A sa sortie pourtant, Maki met ses rêves de mode au placard. Elle réalise qu’elle s’est trompée de voie.
Le hasard la mène alors au graphisme. Elle apprend le métier sur le tas au sein d’une petite agence. Parallèlement, elle économise pour concrétiser son nouveau rêve : retourner à Paris. Le coup de foudre a eu lieu pendant ses années à la Bunka Fashion College Un voyage de fin d’études qui la mène à Paris et à Londres. Maki est bouleversée par sa rencontre avec notre capitale et dès lors ne cessera de penser à un nouveau départ.
En août 1991, elle quitte son job de graphiste et débarque à Paris, un aller simple dans la poche. Elle pense y rester un an. Elle ne quittera jamais la capitale française.
Les premiers mois sont difficiles. Maki est seule, baragouine quelques mots de français. Elle prend des cours à l’Alliance française, se fait des amis, étrangers pour la plupart. Puis, la chance et les rencontres lui sourient. En 1992, elle trouve une place de graphiste dans une petite agence de publicité. Elle y reste cinq ans, le temps de parfaire ses connaissances en français. En 1993, elle rencontre Patrick, son actuel compagnon. Maki pose ses valises. Elle s’installe vraiment.
Pourtant, les années passent et Maki se sent en sursis. Elle attend. Elle guette. Elle redoute l’apparition des premiers symptômes d’une maladie au nom barbare : l’ataxie cérebelleuse type 6. Est-elle porteuse de ce gène maudit, comme sa mère, comme les trois autres générations de femmes précédentes dans la famille ? Elle essaie de croire que non. Comment pourrait-elle être atteinte de cette maladie que porte sa mère, elle qui ressemble tant à son père ? Elle sait aussi qu’elle a une chance sur deux de porter le gène.
En 2005, sa vie bascule. Maki a trente-huit ans. Elle reconnaît la couleur de cette maladie trop familière. Elle était là, depuis toujours, inscrite au plus profond d’elle, dans son ADN. Elle attendait patiemment son heure, la fourbe. Le couperet tombe. Maki est atteinte d’ataxie cérebelleuse type 6. Dès lors, toute sa vie s’organise autour de la maladie. Maki est suivie à l’hôpital de la Salpetrière.
La maladie est progressive, imprévisible. Pertes d’équilibre, difficultés pour parler, démarche incertaine, déficit de coordination des mouvements des membres supérieurs… Si accepter la maladie est un combat de tous les instants, Maki décide de ne pas baisser les bras. Elle poursuit ses activités favorites : cours de flamenco, d’espagnol. Avec Patrick, son compagnon, elle part tous les ans pour des voyages lointains. Cette année, ils ont découvert l’Inde et la Syrie. Elle sait que cela peut s’arrêter, qu’un jour probablement la maladie ne lui permettra plus de danser, voyager, sortir autant qu’elle le voudrait. Il faut prendre de vitesse la maladie.
Mais, le combat est inégal, truqué : l’ataxie gagne du terrain. Maki doit bientôt renoncer aux cours de danse ; la lecture, les déplacements deviennent fastidieux. Elle perd l’équilibre, sa vue se trouble. Elle passe en mi-temps thérapeutique au travail. Elle est déclarée invalide à 80% par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) et perçoit une pension, qui compense partiellement la perte de salaire. Ses après-midis se partagent entre séances de kinésithérapie, orthophonie (pour gérer les troubles de l’élocution), orthoptie (rééeducation de la vision), aquagym. La maladie est incurable, mais une bonne prise en charge médicale et paramédicale permet d’améliorer la qualité de vie.
En 2007, Maki se résout à adopter une canne. Elle s’en félicite aujourd’hui, d’autant qu’en plus de la soulager dans ses déplacements, l’objet sert souvent d’amorce de conversations avec des inconnus. Elle participe à un groupe de parole de patients atteints de la maladie. Parce qu’il est aussi difficile de vivre avec la maladie que de l’accepter. Se vivre comme malade, comme handicapée, identité subie et non choisie. C’est intégrer, comme le dit Maki une nouvelle façon d’être au monde, avec d’autres possibilités, d’autres ouvertures. J’ai encore du chemin à faire, dit-elle doucement, mais je suis sur le chemin.
Des milliers de kilomètres séparent Maki de son village côtier au nord du Japon. Pourtant, c’est son histoire, sa famille qui se rappellent à elle dans cette affaire de maladie. L’ataxie cérébelleuse de Maki parle de transmission, d’héritage obligé. Peut-on échapper à ce qu’on est ? Finalement, qu’importe le pays où nous vivons, car notre histoire, nos racines sont inscrites au plus profond de nous, dans notre ADN. Que nous le voulions ou non. Nous faisons partie d’une chaîne. Dans laquelle parfois la maladie s’inscrit.
Avant de se quitter, Maki me confie : « avant, je voulais être française, comme tout le monde ne pas me sentir étrangère. Aujourd’hui, je sais que je ne peux être que japonaise ». L’année prochaine, si tout va bien, Maki et Patrick partiront en voyage au Sénégal.