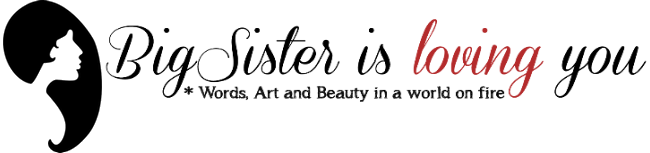Une amie me faisait remarquer que Big Sister ne s’était pas exprimée depuis un certain temps. « Tu as raison », je lui ai répondu. Elle ajouta : « tu n’avais pas le moral ? T’étais crevée ? ». J’ai confirmé la deuxième option qui a une forte incidence sur la première. C’est vrai, j’étais fatiguée, lessivée, exténuée. Comment écrire dans ces conditions ?
Une amie me faisait remarquer que Big Sister ne s’était pas exprimée depuis un certain temps. « Tu as raison », je lui ai répondu. Elle ajouta : « tu n’avais pas le moral ? T’étais crevée ? ». J’ai confirmé la deuxième option qui a une forte incidence sur la première. C’est vrai, j’étais fatiguée, lessivée, exténuée. Comment écrire dans ces conditions ?
Chaque jour, je prépare et porte mes filles à l’école, cours prendre mon train pour enseigner à des lycéens plus intéressés par leurs conversations continues sur leur portable que par mes leçons, cours dans l’autre sens reprendre un train pour rentrer à la maison, mange à toute vitesse les restes du dîner de la veille avant d’aller récupérer les filles à l’école, les fais goûter, les douche, les convaincs à se mettre en pyjama,fais les devoirs avec la grande, prépare le dîner, mange en m’intéressant à leur journée, joue avec elles à un, deux, trois, soleil ou au Memory, les motive pour se laver les dents, leur lis une histoire puis les mets au lit. Et évidemment, pendant tout ce temps, pense aux courses à faire, au lait qu’il faut racheter, aux chaussettes à renouveler pour tout le monde, à la tenue du spectacle pour la grande qu’il faudra acheter, au problème administratif qu’il faudra résoudre, aux cartes d’identité qu’il faudra demander, au cadeau d’anniversaire pour le petit copain de classe qu’il faudra acheter avant de conduire les filles à la dite-fête, aux cours à préparer, aux vacances qu’il faudra organiser, à la petite mine de la dernière – couve quelque chose ou triste ?, etc.… A 21 heures, oui, il y a des raisons d’être lessivée.
 Trouver la force, l’énergie physique et mentale pour allumer mon ordinateur, rassembler mes idées, écrire, chercher des photos, écrire … appelle une volonté surhumaine quand le canapé est là, libre, quand le silence de la maison est une invite directe à m’écrouler pour me mater un bon dvd.
Trouver la force, l’énergie physique et mentale pour allumer mon ordinateur, rassembler mes idées, écrire, chercher des photos, écrire … appelle une volonté surhumaine quand le canapé est là, libre, quand le silence de la maison est une invite directe à m’écrouler pour me mater un bon dvd.
La charge mentale, dernier concept à la mode, c’est le trait de génie d’une illustratrice –Emma– qui, en deux mots, a su exprimer le chemin de croix quotidien, le calvaire, que nous femmes, accomplissons depuis que le monde est monde… Simone de Beauvoir voyait deux catégories de femmes : celles qui font des enfants, celles qui font des livres. Je réalise, chaque jour, combien cette observation est juste. L‘écriture est un sport de combats. Ce n’est pas n’importe lequel. D’abord, l’écriture est un sport réservé à une élite, riche, débarrassée des contingences matérielles. Qui peut penser à écrire quand le frigo est vide, que les enfants crient famine et que les factures sont impayées ? Le luxe, c’est de disposer d’argent certes mais aussi de temps. De temps de qualité. Pour penser à autre chose qu’à sa survie ou à la résolution de questions qui mettent en jeu sa survie. Les fourmis laborieuses, celles qui triment pour arriver à la fin du mois, ne peuvent s’offrir le luxe de la création. L’écriture, c’est aussi un combat contre soi-même. Si je n’ai pas écrit depuis un certain temps, c’est parce que je me suis trouvée face à un dilemne. La question fondamentale que se pose tout lecteur quand il affronte un texte est : « qui parle ? » « d’où ça vient ? ». Écrire pour les autres signifie nécessairement parler de soi, se mettre en danger. Je me suis trouvée bloquée face à cette effrayante perspective. Bien sûr que je veux écrire, mais quel prix suis-je disposée à payer pour cela ? M’exposer totalement -certains y arrivent sans problème-, tout dire, tout raconter ? Si j’utilise un pseudo, c’est par pudeur, c’est mon dernier rempart alors que j’ai l’impression de tellement me révéler. N’est-ce pas suffisant ? Si je suis restée figée ces derniers mois, c’est parce qu’évidemment, je sentais que la réponse était non. Mais je n’ai encore trouvé ni la réponse ni la bonne distance, celle qui permet d’être soi-même sans se sentir complètement nue…. Si vous avez des idées, des conseils… Welcome, my friends.
 J’en reviens à mes dvds. Vu ma vie extraordinairement pleine de maman qui m’interdit de fréquenter les salles obscures – je pense parfois avec nostalgie à mes années parisiennes où, munie de mon pass Gaumont, j’étais la terreur des caissières des cinés de Montparnasse et de Beaubourg. Snif-, j’en consomme une quantité déraisonnable. Mais mon médecin n’a rien de trouvé de préoccupant chez moi, donc c’est que les bons films ne nuisent pas à la santé. Parmi les jolies pépites regardées dernièrement, il y a « Le Sel de la terre » de Wim Wenders et Juliano Salgado. Ce documentaire retrace le parcours d’un photographe-explorateur « spirituel » brésilien, Sebastião Salgado. Beaucoup d’entre vous se seront régalés, sur grand écran, du spectacle de ses clichés en noir et blanc, veinards. Je ne suis pas là pour parler de la virtuosité de Salgado – qui suis-je pour cela ?- mais d’une partie de son histoire. Salgado a travaillé sur de grands projets thématiques, qui l’ont conduit aux quatre coins de la planète. Au centre de son œuvre, son intérêt pour l’homme, sa condition humaine. Dans les années 90, il couvre le génocide rwandais – à ce propos, vous pouvez lire ma chronique du livre Petit Pays de Gaël Faye -. Les photos qu’il en rapporte sont épouvantables. Une partie du film révèle ses clichés. Je n’ai pas pu les regarder. Je n’ai pas pu soutenir le regard, mort, vide, de ces hommes, femmes, enfants, qui semblaient accepter la mort imminente comme une issue certaine et inévitable. Quand Salgado est revenu du Rwanda, il n’est plus le même. Il est brisé. Ce travail, cette fréquentation étroite avec le pire de l’homme le signe pour la vie. Il n’est plus capable de photographier comme avant. Il doit retrouver une raison de croire, de croire en l’homme, d’aimer, à nouveau. La renaissance, c’est la nature qui la lui offre.
J’en reviens à mes dvds. Vu ma vie extraordinairement pleine de maman qui m’interdit de fréquenter les salles obscures – je pense parfois avec nostalgie à mes années parisiennes où, munie de mon pass Gaumont, j’étais la terreur des caissières des cinés de Montparnasse et de Beaubourg. Snif-, j’en consomme une quantité déraisonnable. Mais mon médecin n’a rien de trouvé de préoccupant chez moi, donc c’est que les bons films ne nuisent pas à la santé. Parmi les jolies pépites regardées dernièrement, il y a « Le Sel de la terre » de Wim Wenders et Juliano Salgado. Ce documentaire retrace le parcours d’un photographe-explorateur « spirituel » brésilien, Sebastião Salgado. Beaucoup d’entre vous se seront régalés, sur grand écran, du spectacle de ses clichés en noir et blanc, veinards. Je ne suis pas là pour parler de la virtuosité de Salgado – qui suis-je pour cela ?- mais d’une partie de son histoire. Salgado a travaillé sur de grands projets thématiques, qui l’ont conduit aux quatre coins de la planète. Au centre de son œuvre, son intérêt pour l’homme, sa condition humaine. Dans les années 90, il couvre le génocide rwandais – à ce propos, vous pouvez lire ma chronique du livre Petit Pays de Gaël Faye -. Les photos qu’il en rapporte sont épouvantables. Une partie du film révèle ses clichés. Je n’ai pas pu les regarder. Je n’ai pas pu soutenir le regard, mort, vide, de ces hommes, femmes, enfants, qui semblaient accepter la mort imminente comme une issue certaine et inévitable. Quand Salgado est revenu du Rwanda, il n’est plus le même. Il est brisé. Ce travail, cette fréquentation étroite avec le pire de l’homme le signe pour la vie. Il n’est plus capable de photographier comme avant. Il doit retrouver une raison de croire, de croire en l’homme, d’aimer, à nouveau. La renaissance, c’est la nature qui la lui offre.  Il se rend sur les îles Galapagos pour un nouveau travail, Genesis. Il part sur les traces de la vie, il retourne à la source, celle de la création. Là, il réalise que l’iguane est son cousin. Il se sent, à l’égal des êtres vivant sur terre, part de la création. Il s’apaise.
Il se rend sur les îles Galapagos pour un nouveau travail, Genesis. Il part sur les traces de la vie, il retourne à la source, celle de la création. Là, il réalise que l’iguane est son cousin. Il se sent, à l’égal des êtres vivant sur terre, part de la création. Il s’apaise.
Puis, après des années passées à Paris, il sent l’appel de la « Terra madre ». Il rentre chez lui au Brésil. Il reprend le domaine familial avec sa femme Lélia. Mais la terre ne ressemble plus à celle de ses souvenirs, cette terre verte et riante sur laquelle il jouait, enfant. Le sol épuisé par des années de surexploitation est devenu aride, comme mort. Sur une intuition de sa femme, Lélia, Salgado décide de reboiser les 700 hectares de terrain. Il crée en 1998, l’ONG Instituto Terra, qui plantera et élèvera près de 4 millions d’arbres, sur une terre brûlée qu’on pensait condamnée. La terre revient à la vie. La forêt plantée est pérenne, durable. Salgado a ressuscité les morts. La vie a été plus forte que la mort. Cette forêt nous apprend une chose merveilleuse : il y a des raisons d’espérer.
Toutes les photos sont de © Sebastião Salgado.
Le Sel de la Terre (The Salt of the Earth), Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado, 2014.