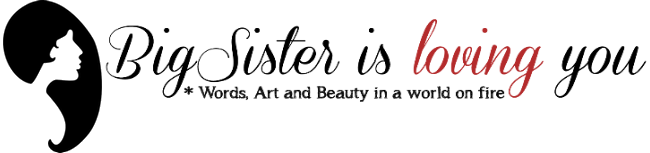Un dimanche matin de soleil, de froid piquant et sec. Parfait pour trouver la motivation nécessaire à l’enfilage de mes blanches baskets. Direction le parc ! Je ne cours pas, je marche. On fait ce qu’on peut, ma p’tite dame… Je me positionne au départ, fière de rejoindre la grande famille des sportifs du dimanche. C’est parti. Nous sommes nombreux en ce dimanche ensoleillé à fouler le ciment du parc. La majorité des coureurs, marcheurs, portent ces nouveaux vêtements techniques qui ont condamné le sweat-shirt à capuche à la retraite, le short pourraves à la poubelle, et le jogging lâche au ménage. Maintenant les escadrons de sportifs du dimanche ont l’air de militaires surentraînés, tout droit sortis d’un camp de Marines. Les t-shirts moulants, les collants exaltent la silhouette, pas un bourrelet qui pourrait se cacher derrière les plis d’un t-shirt XXL, les corps sont découpés avec précision, outils nets, parés pour la performance, l’efficacité. L’objectif de tous : se mesurer à ses propres limites, les dépasser. Pour y arriver : des outils ultra-sophistiqués (vêtements, montre, app) qui promettent d’enregistrer rythme cardiaque, force du vent, nombre de pas, vitesse moyenne, calories brûlées… Le Data man ne laisse rien au hasard. Il contrôle ses pulsations, adapte son allure pour que ses deux heures au parc soient productives. Data man, qui court autour de moi, c’est l’homme de demain, l’homme enfanté par le Big Data, ce monde où tout se mesure, tout est quantifiable, analysable, modélisable. C’est l’homme qui ajuste en permanence ses paramètres, qui a un œil greffé sur un écran, un homme qui pense au futur, qui se veut hyper connecté mais loupe le monde réel, celui dans lequel il respire.
Un dimanche matin de soleil, de froid piquant et sec. Parfait pour trouver la motivation nécessaire à l’enfilage de mes blanches baskets. Direction le parc ! Je ne cours pas, je marche. On fait ce qu’on peut, ma p’tite dame… Je me positionne au départ, fière de rejoindre la grande famille des sportifs du dimanche. C’est parti. Nous sommes nombreux en ce dimanche ensoleillé à fouler le ciment du parc. La majorité des coureurs, marcheurs, portent ces nouveaux vêtements techniques qui ont condamné le sweat-shirt à capuche à la retraite, le short pourraves à la poubelle, et le jogging lâche au ménage. Maintenant les escadrons de sportifs du dimanche ont l’air de militaires surentraînés, tout droit sortis d’un camp de Marines. Les t-shirts moulants, les collants exaltent la silhouette, pas un bourrelet qui pourrait se cacher derrière les plis d’un t-shirt XXL, les corps sont découpés avec précision, outils nets, parés pour la performance, l’efficacité. L’objectif de tous : se mesurer à ses propres limites, les dépasser. Pour y arriver : des outils ultra-sophistiqués (vêtements, montre, app) qui promettent d’enregistrer rythme cardiaque, force du vent, nombre de pas, vitesse moyenne, calories brûlées… Le Data man ne laisse rien au hasard. Il contrôle ses pulsations, adapte son allure pour que ses deux heures au parc soient productives. Data man, qui court autour de moi, c’est l’homme de demain, l’homme enfanté par le Big Data, ce monde où tout se mesure, tout est quantifiable, analysable, modélisable. C’est l’homme qui ajuste en permanence ses paramètres, qui a un œil greffé sur un écran, un homme qui pense au futur, qui se veut hyper connecté mais loupe le monde réel, celui dans lequel il respire.
Ces armées de Data men (et women) me donnent le cafard … Qu’il est triste ce parc où s’agitent en silence ces stakhanovistes de la course, ces ninjas anonymes, si sérieux, si semblables. Et soudain je rêve… Quand il me double, son souffle effleure mon visage. Son visage, rougi par l’effort, ruisselle. Son short blanc en coton colle à ses cuisses. Elles sont poilues, bronzées, musclées. Son T-shirt est trempé. Il porte des gazelles vintage, des chaussettes blanches. Il sent la sueur à dix kilomètres, mais je n’ai qu’une envie : lui coller au train. Coller au train de Dustin Hoffman. Marathon man. Marathon man court, mais il est détendu, cool. Il ignore les courbes d’analyse, la mesure de la performance, il court et ses foulées caressent le ventre du monde.
Rien ne semble exister que le bruit de sa respiration, la foulée parfaite de ses jambes dorées. Marathon man me fera-t-il une place à ses côtés ? Ralentira-t-il son allure pour me permettre de le rejoindre, de rester à sa hauteur ? Ou me considère-t-il, lente comme je suis, comme un frein, un boulet qui ne peut qu’entraver l’accomplissement de ses objectifs, la réalisation de son but ? Au fond, Marathon Man et Data Man ne sont-ils pas deux visages différents d’un même mal, celui de l’individualisme, un individualisme qui exclut l’idée d’accommodements, de renoncements, de frustrations ? Surtout quand la raison de tels sacrifices est seulement l’autre ? L’autre, celui que l’on croise un matin sur sa route, mérite t’il vraiment qu’on modifie ses plans, qu’on révise ses priorités, qu’on redéfinisse ses valeurs ?
Je ne serai jamais capable de courir aussi vite et aussi longtemps que Data Man ou Marathon Man. Je n’ai pas l’entraînement. Et ça ne m’intéresse pas non plus. Je n’aime pas courir. Qu’est-ce qui me reste ? Laisser tomber Marathon Man ? L’oublier parce que j’aurais toujours une longueur de retard sur lui et le monde, trop rapides pour moi ? Devrais-je faire comme ceux qui courent autour de moi : endosser une super panoplie pour tenter de suivre, et ne plus me sentir inadaptée au monde des Big datas, dans lequel internet dicte les temps de vie ? Dois-je embrasser ce monde frénétique comme on embrasse une religion, dans laquelle la recherche de la performance, de la vitesse, ou plutôt de l’hypervitesse sont les normes et les nouveaux dogmes ?
Quand je raisonne, je sens particulièrement le poids des années, celui d’une vie passée avec des expériences très différentes de celles qui sont vécues par les « digital natives » d’aujourd’hui. C’est sûrement ce décalage qui nourrit mon sentiment d’inadaptation. Depuis l’enfance, on me dit que je suis « bizarre ». J’en ai longtemps souffert, car si je ressentais ma différence, je n’arrivais pas à en comprendre la nature ni à en reconnaître la valeur. Être bizarre, c’est se tenir à la marge, être borderline. C’est une position qui permet la fuite mais qui a comme prix un certain isolement. C’est une place qui évite l’écrasement du milieu, du centre, de la masse. C’est la place du funambule, celui qui évolue au dessus du monde, qui risque à tout moment de tomber, car son équilibre est précaire, il ne peut compter que sur ses sens, tous ses sens mobilisés en permanence, il ne doit pas perdre de vue le fil sur lequel il s’appuie, il ne doit pas se laisser distraire par l’agitation du monde autour de lui, il doit résister aux vents qui menacent de le faire vaciller. Il doit rester ferme, maître de son fil, maître de lui. Quand il sent que ses jambes lui obéissent, que son fil lui obéit, il est le plus heureux des hommes. Et le monde qu’il contemple du haut de son fil, lui appartient.
Photos : Marathon Man (1976) de John Schlesinger.